Si la technologie évolue aussi vite, c’est forcément parce qu’on l’adopte à peu près à la même vitesse : preuve que l’homme est une bête éminemment perfectible, comme le rappelait Rousseau dans son Discours sur l’origine et les fondements des inégalité parmi les hommes, qui y énonce une vérité en apparence toute simple pour les modernes que nous sommes aujourd’hui : l’homme devient constamment.
C’est ce qui fait qu’un jour on apprend à se servir de Twitter, et que le lendemain on mord la main de celui qui oserait nous empêcher de nous en servir.
Reste que la rapidité foudroyante de l’adoption technologique n’est pas moins réelle pour autant, qu’on la juge démesurée ou non. Et elle cause de réelles frustrations, autant chez le public que dans le milieu journalistique.
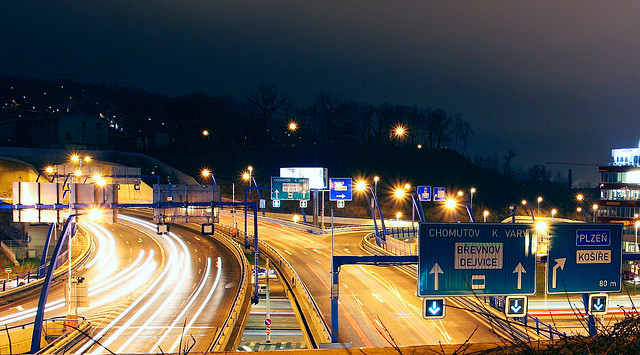
C’est ainsi que Michael D. Shear, journaliste au NY Times, s’indigne (comme plusieurs autres) du fait que la Cour suprême américaine ait interdit l’usage d’autre chose que d’un crayon et d’un calepin à l’intérieur des salles de cour. Le retour à l’âge de pierre, quoi.
Invoquant l’appétit croissant – voire le droit – du public pour une information qui se déroule et prend forme devant lui au gré des événements (via les médias sociaux donc), Shear dénonce ce retour à une vitesse « informationelle » datant de l’ère pré-numérique.
En dépit de ce vibrant plaidoyer, on chercherait en vain une défense convaincante, dans le texte de Shear, de l’utilité réelle, eu égard au droit du public à l’information, de permettre les tweets dans les salles de cour. La question qui sera débattue – l’étude de la constitutionnalité de la réforme de la santé de l’administration Obama – est éminemment d’intérêt public, bien sûr, et le public a tous les droits d’en être informé, personne n’en doute. Mais au nom de quel autre argument que l’instantanéité le public a-t-il le droit d’être informé par le biais de Twitter ? Parce que les médias vivent des « pressions pour rapporter les faits alors qu’ils se produisent » (notre traduction), répond Shear. La vitesse pour la vitesse, donc.
Qu’à cela ne tienne, la question demeure pertinente : à savoir si cette interdiction ne constitue pas une atteinte à la liberté d’expression et à son pendant, le droit du public de recevoir des informations.
Mais même si on répondait par l’affirmative, on n’aurait toujours pas réglé la question, plus importante peut-être, de l’utilité réelle d’une telle pratique.
Gymnastique post-moderne
Début mars, lors du conférence à la Ryerson University, Mary McGuire racontait l’histoire d’une journaliste qui, soucieuse d’être au-devant de toutes les nouvelles en même temps, était devenue une véritable journaliste-contorsionniste : elle se vantait de pouvoir à la fois tweeter une nouvelle, tourner une vidéo avec son portable et tenir une enregistreuse dans sa bouche pour ne rien manquer d’un scrum.
La gymnastique est impressionnante, quand même. Mais est-ce que le public y gagne quelque chose ? « Les médias sont en compétition les uns avec les autres. On veut forcément être celui qui garde les gens les plus informés, le plus rapidement et en temps réel. Est-ce que le public serait moins bien servi si on attendait à la pause avant de tweeter? Pas sûr », répond Vincent Larouche, journaliste affecté à la couverture judiciaire à La Presse, qui est pourtant un gazouilleur de la première heure.
Autrement dit, n’y a-t-il pas lieu, a fortiori lorsqu’il s’agit de raconter une histoire aussi complexe que celle qu’on devrait raconter lors d’un procès, de ralentir un peu la nouvelle? Dans son texte d’ouverture de Nouveau Projet, Nicolas Langelier livrait un éloge à la lenteur :
C’est peut-être pour cette raison que les médias sociaux, malgré leurs nombreux attraits et bénéfices, nous laissent au final avec cette impression de vide et d’inachèvement, ce malaise diffus. Nous avons encore besoin que des gens doués transforment en histoires ce tsunami d’informations et d’émotions qui nous submerge chaque fois qu’on accède à Facebook et Twitter, qu’on ouvre la télé ou juste la fenêtre. Nous avons encore besoin que des auteurs nous aident à trouver un sens — une raison d’être, même — à ces milliards de microrécits et de narrations fracturées. Qu’ils mettent un point à la fin de leur histoire, et que cela suffise, pour un moment.
Seulement, pendant ce « moment », les junkies d’information sentiront qu’ils manquent d’air – de l’air du temps sûrement – et en redemanderont, et la roue continuera de tourner, à la même vitesse. Et éventuellement, un jour, bientôt sûrement, la Cour suprême des États-Unis finira par céder, et les tribunaux québécois aussi. Ce n’est qu’une question de temps, d’époque.
